Introduction
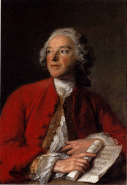
» Quel homme ! il réunit tout, la plaisanterie, le sérieux, la raison, la gaieté, la force, le touchant, tous les genres d’éloquence ; et il n’en recherche aucun, et il confond tous ses adversaires, et il donne des leçons à ses juges. » Voltaire à d’Alembert, à propos de Beaumarchais et de son quatrième Mémoire contre Goëzman, rédigé en 1774.
» Ô bizarre suite d’événements ! Comment cela m’est-il arrivé ? Pourquoi ces choses et non pas d’autres ? Qui les a fixées sur ma tête ? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j’en sortirai sans le vouloir, je l’ai jonchée d’autant de fleurs que ma gaieté me l’a permis ; encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce Moi dont je m’occupe : un assemblage informe de parties inconnues ; puis un chétif être imbécile ; un petit animal folâtre ; un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre ; maître ici, valet là, selon qu’il plaît à la fortune ! ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux… avec délices ! orateur selon le danger ; poète par délassement ; musicien par occasion ; amoureux par folles bouffées, j’ai tout vu, tout fait, tout usé. »
Figaro, scène 3 de l’acte V du Mariage de Figaro de Beaumarchais.
Il y a chez Figaro du Beaumarchais, comme chez Beaumarchais du Figaro : dans Le Barbier de Séville, Figaro est barbier à Séville, Pierre-Augustin Caron est horloger à Paris, comme son père. Figaro le valet sait choisir ses maîtres, le comte Almaviva est un grand d’Espagne, qui reconnaît les mérites de son serviteur ; Caron se fait valet des filles de Louis XV, de la marquise de Pompadour, favorite du roi, et du roi lui-même, en leur fabriquant d’habiles et délicates montres. Figaro, dans Le Mariage, parvient à tenir tête à son maître, par son intelligence et sa gaieté ; Caron, le roturier devient, avec les mêmes armes, le noble Caron de Beaumarchais, et son propre maître. Comme Figaro, Beaumarchais sera donc » maître ici, valet là, selon qu’il plaît à la fortune ! « , et comme lui il pourra dire, à la fin de sa vie » j’ai tout vu, tout fait, tout usé « .
Beaumarchais est considéré aujourd’hui comme l’un des grands personnages du siècle des Lumières, en particulier grâce à sa production théâtrale, et plus précisément aux deux premières pièces de la trilogie que constituent Le Barbier de Séville (1775), Le Mariage de Figaro (1784) et La Mère coupable (1792). Mais la vie même de ce Caron fils d’horloger devenu grand affairiste mondain a contribué, tout autant que son œuvre, à faire de Beaumarchais un homme des Lumières. Si l’on veut tenter de cerner Beaumarchais, il faut, avant que de se plonger dans ses œuvres, se pencher sur sa vie, véritable tourbillon qui vaut la peine d’être évoqué, au moins dans ses grandes lignes. Quant aux productions littéraires, elles sont indissociables des conditions d’existence de Beaumarchais, et, à ce titre, elles ont souvent été une tribune pour cet écrivain soucieux de l’opinion, qui lutta ainsi contre les critiques plus ou moins légitimes dont il a fait l’objet tout au long de sa vie.
Un mot, enfin, du caractère révolutionnaire de l’homme et de son œuvre. Il est évidemment difficile, avec le temps, et malgré le recul qu’il procure, de trancher nettement. De plus, tout est affaire de circonstances, de points de vue, d’idéologie ; écoutons tout d’abord Beaumarchais lui-même :
» J’ai traité avec les ministres de grands points de réformation dont nos finances avaient besoin […]
Luttant contre tous les pouvoirs du clergé et des magistrats, j’ai relevé l’art de l’imprimerie française par les superbes éditions de Voltaire […]
De tous les Français quels qu’ils soient, je suis celui qui a le plus f ait pour la liberté du continent de l’Amérique, génératrice de la nôtre, dont seul j’osai former le plan et commencer l’exécution malgré l’Angleterre, malgré l’Espagne, malgré la France même. […] «
Ces faits avérés montrent que Beaumarchais avait le goût du combat et de la liberté. Certes, comme Figaro, il tentait souvent de » faire à la fois le bien public et particulier « , mais les échecs financiers de la plupart de ses entreprises n’ont pourtant pas suffi à le décourager, lui qui s’est retrouvé ruiné pendant la tourmente révolutionnaire. Il était un homme de son temps, mais il a été dépassé par l’ampleur de la Révolution, comme la plupart de ses contemporains d’ailleurs. Beaumarchais n’était pas un révolutionnaire, mais c’était bien un homme des Lumières, qui a préparé, à sa façon, la Révolution.
Le Barbier de Séville (1775) et Le Mariage de Figaro (1784) étaient-elles des pièces révolutionnaires ? Par certains bons mots, certaines répliques, elles semblent en effet annoncer la Révolution: Figaro, frondeur, dans Le Mariage, s’écrit, seul en scène, en parlant de son maître : » Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie !… noblesse, fortune, un rang, des places ; tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de biens ! vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste homme assez ordinaire ! tandis que moi, morbleu ! perdu dans la foule obscure, il m’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu’on n’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes ; et vous voulez jouter… « . Ajoutons que Louis XVI aurait dit après avoir assisté à une lecture du Mariage : » Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse « , et que Danton a déclaré : » Figaro a tué la noblesse « .
Mais il convient de rappeler que ces pièces ont obtenu l’autorisation d’être jouées, qu’elles n’ont pas choqué outre mesure le public, et que Beaumarchais écrivait dans la préface du Mariage de Figaro : » Pourquoi, dans ses libertés sur son maître, Figaro m’amuse-t-il, au lieu de m’indigner ? C’est que, l’opposé des valets, il n’est pas, et vous le savez, le malhonnête homme de la pièce : en le voyant forcé par son état de repousser l’insulte avec adresse, on lui pardonne tout, dès qu’on sait qu’il ne ruse avec son seigneur que pour garantir ce qu’il aime et sauver sa propriété. » Le personnage de Figaro est donc avant tout un personnage de comédie conçu pour faire rire, comme l’étaient déjà les valets de Molière un siècle plus tôt. D’ailleurs Figaro, barbier indépendant au début du Barbier de Séville (1775), va reprendre son service auprès de son ancien maître, et deviendra dans La Mère coupable (1792), dernière pièce de la trilogie, un » vieux serviteur très attaché » : le parcours social de ce valet n’a rien de révolutionnaire, on en conviendra. Il est cependant indéniable que la Révolution a trouvé dans le personnage de Figaro un symbole éloquent, et dans les bons mots de ce valet de comédie des maximes frappantes, célèbres encore aujourd’hui, celles-ci par exemple : » Aux vertus qu’on exige dans un domestique, Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d’être valets ? » ; » un grand nous fait assez de bien quand il ne nous fait pas de mal » ; » – Une réputation détestable ! – Et si je vaux mieux qu’elle ? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant ? » ; » Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si légers sur le mal qu’ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil ! je lui dirais… que les sottises imprimées n’ont d’importance, qu’aux lieux où l’on gêne le cours ; que sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ; et qu’il n’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits « . Cependant, cet esprit contestataire se trouvait déjà chez Voltaire que Beaumarchais admirait, et Figaro a peut-être surtout eu la chance de paraître sur la scène au bon moment : les circonstances l’ont sans doute fait plus révolutionnaire qu’il ne l’était. Mais le succès des comédies de Beaumarchais, encore aujourd’hui, atteste leur valeur intrinsèque et leur caractère toujours actuel, même si la Révolution est loin désormais : » Et Figaro est immortel… «
Clémence Camon
Biographie
« Avec de la gaieté et même de la bonhomie, j’ai eu des ennemis sans nombre et n’ai pourtant jamais croisé, jamais couru la route de personne. À force de m’arraisonner j’y ai trouvé la cause de tant d’inimitiés. En effet, cela devait être.
Dès ma folle jeunesse, j’ai joué de tous les instruments. Mais je n’appartenais à aucun corps de musiciens. Les gens de l’art me détestaient.
J’ai inventé quelques bonnes machines ; je n’étais pas des corps mécaniciens. L’on y disait du mal de moi.
Je faisais des vers, des chansons. Mais qui m’eût reconnu poète ? J’étais le fils d’un horloger.
N’aimant pas le jeu du loto, j’ai fait des pièces de théâtre. Mais on disait : de quoi se mêle-t-il ? Pardieu ! ce n’est pas un auteur ; car il fait d’immenses affaires et des entreprises sans nombre.
Faute de rencontrer qui voulût me défendre, j’ai imprimé de grands mémoires pour gagner des procès qu’on m’avait intentés et que l’on peut nommer atroces. Mais on disait : vous voyez bien que ce ne sont point des factums comme les font nos avocats. Inde irae. Il n’est pas ennuyeux à périr ! Souffrira-t-on qu’un pareil homme prouve sans nous qu’il a raison ?
J’ai traité avec les ministres de grands points de réformation dont nos finances avaient besoin ; mais on disait : de quoi se mêle-t-il ? Cet homme n’est point financier !
Luttant contre tous les pouvoirs du clergé et des magistrats, j’ai relevé l’art de l’imprimerie française par les superbes éditions de Voltaire, entreprise regardée comme au-dessus des forces d’un particulier. Mais je n’étais point imprimeur. On a dit le diable de moi.
[…]
J’ai fait le haut commerce dans les quatre parties du monde. Mais je n’étais point armateur. On m’a dénigré dans nos ports.
[…]
J’ai traité des affaires de la plus haute politique. Et je n’étais point classé parmi les négociateurs.
De tous les Français quels qu’ils soient, je suis celui qui a fait le plus pour la liberté du continent de l’Amérique, génératrice de la nôtre, dont seul j’osai former le plan et commencer l’exécution malgré l’Angleterre, l’Espagne, malgré la France même. Mais j’étais étranger à tous les bureaux des ministres.
[…]
Qu’étais-je donc ? Je n’étais rien, que moi, et moi tel que je suis resté, paresseux comme un âne et travaillant toujours, en butte à mille calomnies, mais heureux dans mon intérieur. Libre au milieu des fers, serein dans les plus grands dangers, n’ayant jamais été d’aucune coterie ni littéraire, ni politique, ni mystique, faisant tête à tous les orages, un front d’airain à la tempête, les affaires d’une main et la guerre de l’autre. N’ayant fait de cour à personne, et partant, repoussé de tous. N’étant membre d’aucun parti et surtout ne voulant rien être, par qui pourrais-je être porté ? Je ne veux l’être par personne. »
C’est en ces termes que se dépeint Beaumarchais vers la fin de sa vie. L’autoportrait est juste, et rappelle, est-ce vraiment étonnant, celui de Figaro dans Le Barbier de Séville, » garçon apothicaire […] dans les haras d’Andalousie » mais aussi poète, renvoyé par le Ministre » sous prétexte que l’amour des Lettres est incompatible avec l’esprit des affaires « .
Beaumarchais l’explique clairement, il a eu le tort de ne jamais choisir, de ne jamais se fixer dans une charge, un état, un personnage, comme le prouve cette courte biographie :
Né à Paris le 24 janvier 1732, fils d’horloger devenu horloger lui-même après des études dont on sait peu de choses, inventeur d’un ingénieux mécanisme rendant les montres plus fiables (1753), harpiste et maître de harpe des filles de Louis XV (1759), ami d’un richissime financier, Pâris-Duverney, qui l’associe à ses affaires (à partir de 1760), et lui permet de bâtir sa fortune, Secrétaire du roi (1761), puis Lieutenant général des chasses (1763), organisateur de l’exploitation de la forêt de Chinon (1766), avocat plaidant sa cause, plaignant déchu de ses droits civiques (1773-1774), espion ayant maille à partir avec le mystérieux chevalier d’Éon pour le compte de Louis XV, sous le nom de chevalier de Ronac (anagramme de Caron) (1775), fondateur de la Société des auteurs dramatiques (1777), qui protège les droits des auteurs contre les troupes d’acteurs indélicates, soutien de la cause indépendantiste de la jeune Amérique (1775), imprimeur en Allemagne des œuvres complètes de Voltaire (1784-1789), investisseur dans la Compagnie des Eaux de Paris (1781), et à cette occasion, ennemi déclaré de Mirabeau, que pourtant il respecte (1785), propriétaire jalousé d’une somptueuse demeure édifiée près de la Bastille (1787), député à la Commune de Paris en 1789, marchand de fusils pour l’armée française révolutionnaire (1792), mais suspect inscrit sur la liste des émigrés et comme tel, indésirable en France (1793), affairiste ruiné dans la tourmente révolutionnaire, » le citoyen Caron Beaumarchais, homme de lettres « , s’éteint le 17 mai 1799, trois ans après son retour à Paris.
Et les lettres, dans tout cela ? Beaumarchais a encore trouvé du temps pour écrire, non seulement la célèbre trilogie de Figaro, mais aussi un certain nombre de mémoires [Mémoires contre Goëzman (1773-1774), Mémoires contre Kornman (1787-1789), Les Six Époques (sur l’affaire des fusils de Hollande, 1793),] dans lesquels il plaidait sa cause et attaquait fermement ses adversaires tout en se conciliant les faveurs de l’opinion publique. Il a également composé, au début de sa carrière, dans les années 1760, quelques pièces de théâtre au comique assez trivial, destinées à être jouées dans des cercles privés, puis deux drames, Eugénie (1767) et Les Deux Amis ou le Négociant de Lyon (1770), et un opéra » oriental » en cinq actes, Tarare (1787), dont Salieri compose la musique, mais aussi un texte théorique, Essai sur le genre dramatique sérieux (1767). Enfin, il a laissé une très abondante correspondance, ce qui n’est guère étonnant de la part d’un homme qui aimait à mener tant de projets de front, ayant le goût de l’intrigue plus que l’ambition de la réussite, et selon ses propres mots, » paresseux comme un âne et travaillant toujours, en butte à mille calomnies, mais heureux dans [s]on intérieur. Libre au milieu des fers, serein dans les plus grands dangers, n’ayant jamais été d’aucune coterie ni littéraire, ni politique, ni mystique, faisant tête à tous les orages, un front d’airain à la tempête, les affaires d’une main et la guerre de l’autre. «
Clémence Camon
Oeuvres
1753 : Mémoire à l’Académie des sciences, grâce auquel il prouve qu’il est l’inventeur d’un ingénieux mécanisme de montre, dont Lepaute, horloger du roi, a tenté de s’attribuer la paternité.
1757-1763 : œuvres de théâtre inspirées de la commedia dell’arte, destinées à être jouées dans des salons privés : Colin et Colette ; Les Bottes de sept lieues ; Léandre marchand d’agnus, médecin et bouquetière ; Jean-Bête à la foire, Zizabelle mannequin.
1765 : Le Sacristain, » intermède imité de l’espagnol « , ébauche de ce qui deviendra Le Barbier de Séville.
1767 : Eugénie, drame, demi-succès; Essai sur le genre dramatique sérieux.
1770 : Les Deux Amis, drame, échec.
1773-1774 : Mémoires contre Goëzman : Beaumarchais était l’ami du financier Pâris-Duverney, et son associé dans certaines affaires. Pâris-Duverney meurt et son légataire, le comte de La Blache conteste un arrêté de comptes signé entre Beaumarchais et le financier et intente un procès à ce dernier. Beaumarchais perd, fait appel, et se fait un nouvel ennemi, le conseiller Goëzman, rapporteur du procès La Blache, qui accuse même Beaumarchais d’avoir tué ses deux premières épouses. Les quatre mémoires visent à exposer son cas, dénoncer les malversations et la corruption des juges, et surtout à s’attirer les bonnes grâces de l’opinion publique. Beaumarchais obtient définitivement gain de cause en 1778, il est entièrement réhabilité.
1775 : Le Barbier de Séville, achevé en 1773, est porté à la scène, mais allongé d’un cinquième acte et alourdi par de nombreuses allusions à l’affaire Goëzman. Il connaît l’échec le 23 février 1775. Beaumarchais remanie la pièce, qui triomphe le 26 février. Avec finesse et humour, l’auteur, dans la préface du Barbier intitulée » Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de Séville « , revient sur ces modifications et expose l’intrigue de la pièce : » Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa pupille ; un jeune amant plus adroit le prévient, et ce jour même en fait sa femme, à la barbe et dans la maison du tuteur. « . L’intrigue est simple, et la réussite de la pièce tient en grande partie au personnage de Figaro, barbier à Séville, qui, reprenant du service auprès du comte Almaviva va l’aider à enlever la belle Rosine à son tuteur, Bartholo. Beaumarchais dans la préface du Mariage de Figaro écrit : » Me livrant à mon gai caractère, j’ai […] tenté, dans Le Barbier de Séville, de ramener au théâtre l’ancienne et franche gaieté, en l’alliant avec le ton léger de notre plaisanterie actuelle ; mais comme cela même était une espèce de nouveauté, la pièce fut vivement poursuivie. Il semblait que j’eusse ébranlé l’État ; l’excès de précautions qu’on prit et des cris qu’on fit contre moi décelait surtout la frayeur que certains vicieux de ce temps avaient de s’y voir démasqués. La pièce fut censurée quatre fois, cartonnée trois fois sur l’affiche à l’instant d’être jouée, dénoncée même au Parlement d’alors ; et moi, frappé de ce tumulte, je persistais à demander que le public restât le juge de ce que j’avais destiné à l’amusement du public.
Je l’obtins au bout de trois ans. Après les clameurs, les éloges ; et chacun me disait tout bas : » Faites-nous donc des pièces de ce genre, puisqu’il n’y a plus que vous qui osiez rire en face. «
Un auteur désolé par la cabale et les criards, mais qui voit sa pièce marcher, reprend courage, et c’est ce que j’ai fait. […] je composai cette Folle Journée [sous-titre du Mariage de Figaro], qui cause aujourd’hui la rumeur. […] «
1781 : La comédie Le Mariage de Figaro ou La Folle Journée est achevée, mais n’est autorisée définitivement qu’en 1784. Entre temps, Beaumarchais multiplie les lectures privées afin de disposer favorablement les censeurs à son égard.
1784 : triomphe du Mariage de Figaro. On retrouve dans cette comédie les personnages principaux du Barbier de Séville : Figaro doit épouser Suzanne, qui est au service de la comtesse Almaviva, la Rosine épousée par le comte Almaviva à la fin du Barbier. Mais ce dernier, » las de courtiser les beautés des environs, […] veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme « … Il a des vues sur la fiancée de Figaro. Ce dernier va devoir se démener pour faire échouer les projets du comte, et échapper aux assiduités de Marceline, qui veut le contraindre au mariage, avec l’aide de Bartholo, qui n’a pas oublié que Figaro lui a soufflé Rosine pour la donner au comte. Il faudra bien cinq actes à cette comédie pour que » tout fini[sse] par des chansons » – ce sont les derniers mots du Mariage-, que le comte retombe amoureux de la comtesse, que Figaro épouse Suzanne, et que Marceline et Bartholo découvrent qu’ils sont en fait les parents de Figaro !
1787 : Tarare, opéra » oriental » en cinq actes, musique de Salieri.
1788 : Mémoires contre Bergasse : cette fois, Beaumarchais, à la demande d’un ami, a pris la défense d’une femme, Mme Kornman, persécutée par son mari, un banquier. L’affaire s’envenime et l’avocat du banquier, un certain Bergasse, va multiplier les attaques contre Beaumarchais. En 1789, Kornman et Bergasse sont condamnés pour calomnie, mais la réputation et l’enthousiasme de Beaumarchais ne sont pas indemnes, il est désormais suspect aux yeux de l’opinion, sa fortune et son entregent faisant des jaloux.
1792 : L’Autre Tartuffe ou la Mère coupable, drame ; demi-échec. Reprise triomphale en 1797. Beaumarchais renoue avec un genre qu’il apprécie, le drame. Dans la dernière pièce de la trilogie, le couple Almaviva se trouve menacé par un nouveau Tartuffe, M. Bégearss ( on reconnaît sans difficulté sous l’anagramme le dernier ennemi de Beaumarchais, l’avocat Nicolas Bergasse ). Ce dernier, selon Figaro, entend » séparer le mari de la femme, épouser la pupille et envahir les biens d’une maison qui se délabre. » La pièce s’achève sur l’échec des noirs desseins de Bégearss et le triomphe de la morale, puisque Figaro déclare : » chacun a bien fait son devoir […] On gagne assez dans les familles quand on expulse un méchant. » Cette pièce n’a évidemment pas le charme léger et gai des deux comédies précédentes, mais Beaumarchais considère qu’elle est bien la suite des deux comédies, comme il l’écrit dans la préface de La Mère coupable : » J’ai donc pensé […] que nous pouvions dire au public : » Après avoir bien ri, le premier jour, au Barbier de Séville, de la turbulente jeunesse du comte Almaviva, laquelle est à peu près celle de tous les hommes ;
» Après avoir, le second jour, gaiement considéré, dans La Folle Journée, les fautes de son âge viril, et qui sont trop souvent les nôtres ;
» Par le tableau de sa vieillesse, et voyant La Mère coupable, venez vous convaincre avec nous que tout homme qui n’est pas né un épouvantable méchant finit toujours par être bon, quand l’âge des passions s’éloigne, et surtout quand il a goûté le bonheur si doux d’être père ! C’est le but moral de la pièce. » »
1793 : Les Six époques, mémoire sur l’affaire des fusils de Hollande : Beaumarchais a projeté d’acheter des fusils en Hollande, pour la France. Mais il se trouve pris dans un véritable imbroglio politique et financier, et tantôt soutenu par le pouvoir, tantôt persécuté par lui, il devient indésirable pour tous. Dans ce mémoire, encore une fois, il s’explique et se défend.
Clémence Camon

Bibliographie, pour aller à l’essentiel:
- article » Beaumarchais » de Jean-Pierre de Beaumarchais, Dictionnaire des littératures de langue française, sous la direction de J.-P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey, Bordas, 1987.
- Beaumarchais, Le Voltigeur des Lumières, Jean-Pierre de Beaumarchais, Découvertes Gallimard, 1996.
- Beaumarchais ou la bizarre destinée, René Pomeau, PUF, 1987 .
- Beaumarchais, Œuvres, édition établie par Pierre Larthomas, bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1988.
- article » Beaumarchais » du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, Larousse, 1867, tome 2.
Liens
A venir …..
